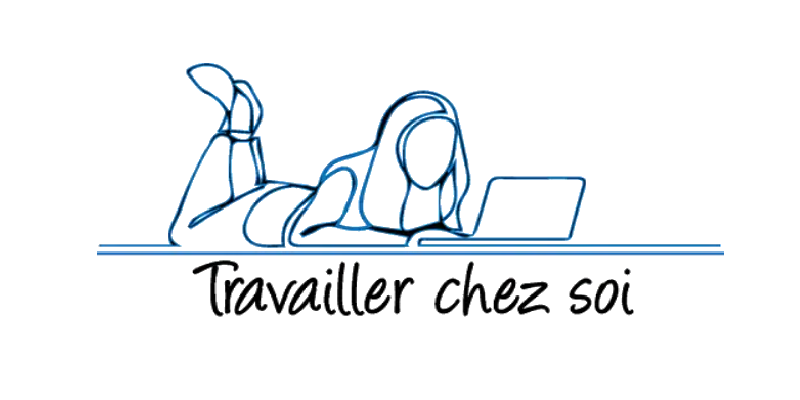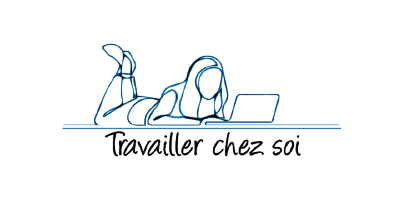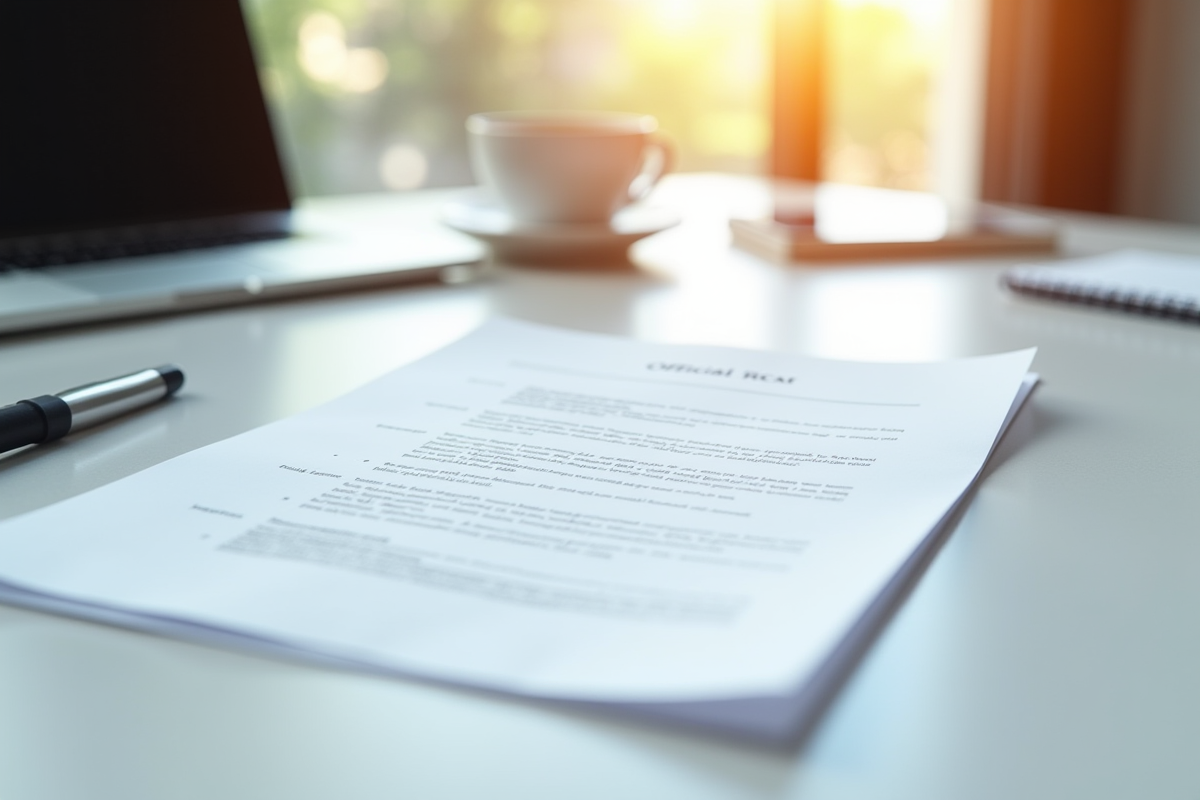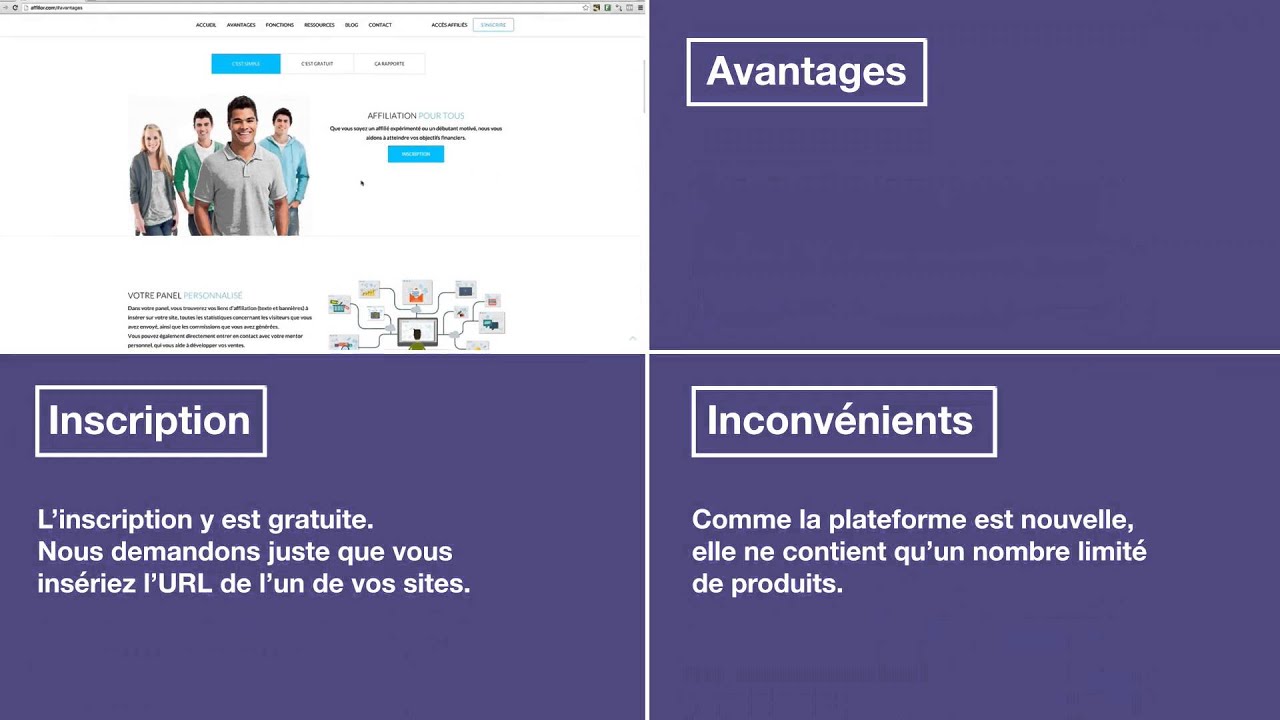En France, la transmission d’instructions officielles au sein de la fonction publique s’appuie sur un dispositif normatif précis. Certaines circulaires, bien qu’elles ne possèdent pas de valeur législative, s’imposent pourtant dans l’application quotidienne des politiques publiques. Leur publication s’accompagne souvent de conditions strictes quant à leur contenu, leur diffusion et leur portée.
La distinction entre circulaire interprétative et circulaire impérative échappe fréquemment à ceux qui en dépendent. Les enjeux liés à l’éducation aux médias, à l’éducation prioritaire et à la transition écologique se traduisent par une multiplication de ces textes, qui orientent concrètement les pratiques sur le terrain.
Circulaires officielles : quel rôle dans l’éducation et la transition écologique ?
La circulaire officielle agit comme un instrument de pilotage, souvent silencieux, mais toujours décisif. Dans le champ de l’éducation nationale, ce texte façonne les usages, trace les lignes directrices et impose les priorités. Dès la rentrée 2025, la circulaire et le plan Avenir ont remodelé le paysage : formations obligatoires à l’intelligence artificielle pour les élèves de 4e et de 2de, affirmation de l’autonomie des établissements, volonté de renforcer l’égalité des chances. Chaque circulaire, loin d’être un simple vade-mecum, inscrit les établissements dans un mouvement de fond où l’adaptation aux réalités sociales devient une exigence quotidienne.
Sur la question écologique, la circulaire SPE n°6425-SG du 21 novembre 2023 offre un cap sans ambiguïté : quinze engagements précis pour transformer l’État. Ce socle, construit autour du dispositif Services publics écoresponsables (SPE) et orchestré par le Commissariat général au développement durable (CGDD), fixe la barre haut. L’État doit désormais être exemplaire en matière d’écologie. Le plan d’action s’articule entre rénovation énergétique des bâtiments, lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective et promotion d’une économie circulaire ambitieuse.
Voici les principaux axes d’action détaillés par ces circulaires :
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre : la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) impose des objectifs précis à chaque secteur d’activité.
- Interdiction progressive du plastique à usage unique : la loi AGEC s’impose à l’ensemble des établissements publics, sans exception.
- Déploiement du plan national achats durables (PNAD) : désormais, chaque commande publique doit soutenir la transition écologique.
Mais la circulaire ne se contente pas d’édicter des règles. Elle accompagne le changement, balise le chemin, et veille à la cohérence de l’action publique. Les comités de suivi, sous la houlette de Claire Landais, réunissent préfets, secrétaires généraux et directeurs pour mesurer la progression réelle de la transition. De l’école primaire aux ministères, la France cherche à ancrer l’ambition réglementaire dans la réalité du terrain. L’État ne se contente plus de décréter : il suit, évalue, ajuste, jusqu’à ce que chaque engagement prenne forme dans la vie quotidienne.
Pourquoi l’émission d’une circulaire façonne-t-elle les priorités éducatives et environnementales ?
La circulaire officielle n’a rien d’une simple formalité. Dès sa publication, elle imprime un rythme, clarifie les attentes, ordonne les priorités. Dans l’éducation nationale, chaque circulaire agit comme une boussole : inclusion, égalité des chances, adaptation à l’évolution des connaissances scientifiques. Prenons la circulaire de rentrée 2025 : elle ancre la formation à l’intelligence artificielle dans le parcours de tous les élèves de 4e, tout en resserrant la lutte contre les inégalités territoriales.
Du côté de l’environnement, la circulaire SPE n°6425-SG, publiée en novembre 2023, s’inscrit pleinement dans la trajectoire de la stratégie nationale bas-carbone et du plan de transformation écologique de l’État. Elle intègre des dispositifs concrets : plan national achats durables, feuille de route numérique et environnement, application stricte des lois Egalim, AGEC, Climat-Résilience. Sur le terrain, cela veut dire rénovation des bâtiments publics, réduction marquée des émissions de gaz à effet de serre, lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines.
Les mécanismes de suivi, garants d’une réelle transformation, s’organisent ainsi :
- Le comité de suivi annuel SPE réunit chaque année autour de Claire Landais les préfets, directeurs et ministres pour faire le point sur l’état d’avancement des mesures.
- Les établissements doivent transmettre des données concrètes, attestant de la progression de leurs indicateurs tant écologiques que pédagogiques.
En publiant une circulaire, l’État ne se limite pas à exprimer une volonté : il actionne les leviers nécessaires pour que le développement durable et l’innovation pédagogique s’ancrent dans la réalité quotidienne, à tous les échelons.
Décryptage : éducation aux médias, éducation prioritaire et stratégie bas-carbone dans les politiques publiques
La stratégie nationale bas-carbone (SNBC) fixe la trajectoire : neutralité carbone pour 2050, réduction massive des émissions, budgets carbone par secteur. La France vise une baisse de 40 % de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2040 (par rapport à 1990). Les circulaires officielles traduisent ce cap en mesures très concrètes : la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) impose l’indice de réparabilité, puis l’indice de durabilité, qui s’appliquent désormais aux équipements publics et influent sur les stratégies d’achat et de gestion du patrimoine immobilier.
Dans le monde éducatif, la circulaire de rentrée 2025 ne se contente pas d’annoncer des ambitions. Elle les rend tangibles. Le plan Avenir s’incarne par le déploiement de cités éducatives, de pôles d’appui à la scolarité, mais aussi par une formation obligatoire à l’intelligence artificielle pour tous les élèves de 4e et de 2de via la plateforme Pix. Cette dynamique s’étend à l’éducation prioritaire, où l’égalité des chances et l’accompagnement à l’orientation deviennent des priorités opérationnelles.
L’économie circulaire s’impose progressivement comme colonne vertébrale de l’action publique : réduction de 30 % de la consommation de ressources d’ici 2030, près de 800 000 emplois concernés, lutte contre le gaspillage et diminution de la dépendance aux matières premières importées. Les circulaires orchestrent cette mutation, en mobilisant les acteurs de terrain : enseignants, chefs d’établissement, collectivités locales. Chacune d’elles vient légitimer et soutenir des démarches concrètes, de la rénovation des bâtiments à la formation continue via les EAFC.
À l’échelle européenne, la Commission agit aussi : le plan d’action pour l’économie circulaire vise la production de biens durables, le développement du droit à la réparation et une forte réduction des déchets. En France, les circulaires s’en font l’écho, pour que l’administration, les écoles et les territoires inscrivent ces impératifs dans leur fonctionnement quotidien.
Comprendre les enjeux pour agir : vers une école plus responsable et engagée
L’école s’est transformée. Elle ne se borne plus à la transmission des savoirs, mais devient le laboratoire vivant de la transition écologique. Le ministère de l’Éducation nationale s’appuie sur la force des circulaires officielles pour décliner des actions concrètes : réduction du gaspillage, rénovation énergétique, intégration de modules sur l’intelligence artificielle et la sobriété numérique.
La réussite de ces mutations repose sur une implication collective. Voici comment les différents acteurs s’engagent :
- Les équipes éducatives modifient leurs pratiques : pédagogies actives, projets interdisciplinaires, actions de sensibilisation aux Objectifs de Développement Durable (ODD).
- Les achats publics responsables, grâce au dispositif SPASER, prennent en compte des critères sociaux et environnementaux dès la passation de contrat.
La formation continue évolue elle aussi : les EAFC proposent de nouveaux modules sur l’économie circulaire, la transition énergétique ou l’alimentation durable, en lien direct avec la SNBC et la loi AGEC. Agents, enseignants et élèves profitent désormais de ressources numériques, via la plateforme Pix, pour renforcer leurs compétences.
La France se fixe une feuille de route ambitieuse : réduire de 22 % les émissions de gaz à effet de serre de l’État d’ici 2027. La circulaire SPE n°6425-SG impose à chaque établissement d’intégrer le développement durable dans ses projets. Difficile d’ignorer la mue à l’œuvre : l’école, reflet des dynamiques territoriales, devient un moteur de la transition, portée par des textes qui guideront et mesureront chaque pas accompli.